
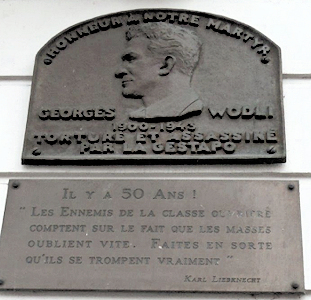
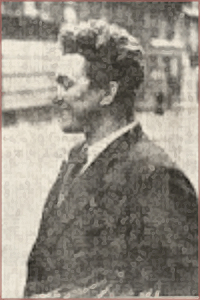
Né le 15 juillet 1900 à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin),
exécuté par pendaison le 1er (ou le 2) avril 1943 à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
ouvrier ajusteur ; secrétaire de l’Union des syndicats CGTU de cheminots
d’Alsace et de Lorraine, membre du comité central du PCF ; résistant.
 |
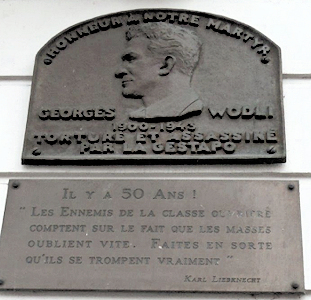 |
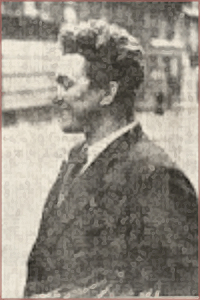 |
Deuxième fils d’un ouvrier d’équipe des chemins de fer
d’Alsace-Lorraine, ancien apprenti cordonnier, lui-même fils de cheminot,
Georges Wodli resta dans son village natal jusqu’en 1904. La famille, avec ses
cinq garçons, résida ensuite à Soufflenheim, puis à Haguenau. Georges Wodli
suivit une formation d’apprenti ajusteur aux ateliers du matériel de Bischheim.
Ayant obtenu son brevet de compagnon, il fut incorporé en 1918 dans l’aéronavale
allemande durant les derniers mois de la Première Guerre mondiale. Affecté à
Kiel (Allemagne), il participa aux mutineries de la Flotte et à la
fraternisation des marins avec le prolétariat révolutionnaire. Il adhéra au
Parti socialiste allemand. Rentré en Alsace devenue française, il reprit sa
place aux ateliers de Bischheim du nouveau réseau d’Alsace et de Lorraine.
Une fois accompli son service militaire dans la marine à
Toulon de 1920 à 1922, Georges Wodli s’installa à Paris comme ouvrier ajusteur,
travaillant successivement chez Renault, Forman puis Hispano-Suiza. De retour en
décembre 1925 en Alsace, marié à Salomé Felten, née le 12 octobre 1903 à
Bischheim, morte à Hoehnheim (Bas-Rhin) le 2 mai 2000, il s’installa à
Schiltigheim et reprit son ancien emploi aux ateliers de Bischheim.
Adhérent depuis juillet 1920 du Parti socialiste, Georges
Wodli avait rallié la Section française de l’Internationale communiste (SFIC)
après son service militaire. Il resta au Parti communiste (PC) après la scission
alsacienne de juillet 1929 et entra en octobre 1930 au bureau de la Région
d’Alsace-Lorraine du PC, un bureau spécial aux pouvoirs étendus. Il fit, cette
année-là, un voyage en URSS où il rédigea une autobiographie en allemand le 22
janvier 1932. L’année suivante la commission des cadres note dans son dossier «
Bon. À suivre pour l’EL [l’École léniniste de Moscou] » ; finalement sa
candidature ne fut pas retenue en raison de son âge. Il militait également à la
Fédération CGTU des cheminots, et devint en avril 1930 secrétaire administratif
permanent de l’Union des syndicats de cheminots d’Alsace et de Lorraine en
remplacement de Lorenz, décédé, puis entra en 1934 au bureau fédéral. Il fut
l’un des quatre délégués de l’Union CGTU à la commission créée le 9 décembre
1934, qui aboutit le 26 mai 1935 à la fusion de l’Union des syndicats CGTU de
cheminots d’Alsace et de Lorraine, de la Fédération des syndicats
professionnels, de l’Union CGT, du Syndicat des échelles 5 à 10. Il fut élu au
bureau de la commission exécutive avec le titre de secrétaire administratif. Il
était alors le cinquième dans la hiérarchie syndicale du réseau.
Candidat communiste en 1932 aux élections législatives à
Molsheim, Georges Wodli n’avait rassemblé que 1.330 voix contre 10.891 en faveur
d’Henri Meck, candidat de l’Union populaire républicaine (le parti catholique
alsacien). Il fit partie de la délégation communiste lors de la première
entrevue avec la direction de la SFIO le 14 juillet 1934. S’étant présenté dans
la même circonscription aux élections législatives de 1936, il recueillit 2.658
voix, en seconde position derrière Henri Meck.
Georges Wodli fut élu membre du comité central du PCF en
1932 et réélu en 1936. L’année suivante, au congrès d’Arles, il n’était plus que
suppléant. En fait, depuis 1933, il se consacrait à l’aide à la résistance
communiste allemande, participant à l’édition de Die Rote Fahne et de Die
Deutsche Volkszeitung, journaux clandestins qu’il faisait parvenir en Allemagne
par la Suisse, animant des campagnes en faveur des militants allemands
antifascistes victimes des nazis, tels Ernst Thaelmann, Edgar André, Liselotte
Hermann et autres opposants au régime hitlérien. Il fut en 1935 l’un des
organisateurs des Olympiades ouvrières européennes de musique et de chant à
Strasbourg.
Mobilisé en 1939 comme affecté spécial aux ateliers de
Bischheim, puis muté au dépôt de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) en
janvier 1940, Georges Wodli fut rappelé au dépôt du génie d’Épinal, puis affecté
à la 1ère Compagnie spéciale du génie, au camp de Saint-Benoît (Seine-et-Oise).
Renvoyé à Gretz au bout de six semaines, il fut arrêté le 30 avril sur son lieu
de travail. Interné dans divers camps à partir du 30 avril, il fut transféré à
Fort-Barraux à Roybon (Isère) d’où il s’évada le 2 septembre 1940 pour rejoindre
alors la région parisienne après de longues journées de marche. Il fut alors
condamné à dix ans de prison par défaut par le tribunal militaire de Lyon pour
désertion.
Refusant l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le Reich,
devenu au printemps 1941, sous le pseudonyme de Jules, délégué interrégional du
comité central clandestin pour l’Alsace et la Lorraine, Georges Wodli s’attela à
la reconstitution du Parti communiste dans les trois départements placés sous
régime allemand, organisant le mouvement de résistance, notamment à partir des
centres cheminots de Basse-Yutz, Montigny-les-Metz, Sarreguemines, Bischheim,
Mulhouse, avec le relais de ses adjoints, Georges Mattern pour le Bas-Rhin et
Jean Burger, dirigeant l’important groupe Mario, dont Wodli était l’un des
fondateurs, en Moselle. Le sabotage de l’exploitation ferroviaire,
l’organisation de filières de passage entre les zones française et annexée,
l’aide à l’évasion des prisonniers français, soviétiques, polonais dans les
camps allemands installés en Alsace-Lorraine, la diffusion de tracts
constituèrent des formes privilégiées d’action des groupes qu’il dirigea.
Les cheminots communistes membres du Groupe Mario avaient
mis en place deux filières pour faire passer clandestinement la frontière vers
la France à leur camarade Georges Wodli. L’une par Hagondange où un membre du
groupe entrait en contact avec Louis Gutfried qui se chargeait de l’héberger
clandestinement au domicile d’un voisin. Louis Gutfried s’occupant ensuite du
passage clandestin de la frontière. L’autre filière, par Moyeuvre-Grande
(Lorraine annexée), était organisée autour des mineurs de fer qui le faisaient
passer clandestinement dans les wagonnets de la mine.
Georges Wodli, qui avait échappé à grande-peine à la police
le 21 septembre 1941 à Gretz, fut arrêté le lendemain à Orly, mais il aurait
réussi à persuader un inspecteur de police de le libérer.
Dans une note les Autorités allemandes avaient signalées
que Georges Wodli était susceptible de se trouver en zone non occupée, et de
développer l’action illégale, en particulier chez les cheminots. Il fut surpris
en plein sommeil par des inspecteurs de la BS2 des Renseignements généraux le 30
octobre 1942 à Chatou (Seine-et-Oise, Yvelines). Lors de son arrestation, il
était en compagnie de Germaine Laguesse.
Fouillé, il portait sur lui la somme de dix mille francs.
En fuite depuis l’été 1941, il faisait l’objet depuis le 13 août d’une note des
Autorités allemandes demandant son arrestation. Depuis les recherches avaient
été vaines. Il avait été signalé comme étant susceptible d’être en zone non
occupée, et de s’occuper de l’action illégale, en particulier dans les milieux
dirigeants des cheminots. Il était inconnu aux archives de la Police judiciaire
et n’était pas noté aux Sommiers judiciaires.
Interrogée sur sa présence avec Georges Wodli, Germaine
Laguesse répondit qu’elle fit sa connaissance « tout à fait par hasard, je l’ai
hébergé parce qu’il était mon ami ». Sa réponse a été qualifiée par l’un des
policiers d’un mot « invraisemblable ».
Georges Wodli retraça son parcours militant, son engagement
au sein du Parti communiste depuis le Congrès de Tours en 1920 jusqu’à son
internement à Fort Barrau le 30 avril 1940, puis son évasion le 2 septembre de
la même année. Il résidait depuis une date qu’il ne précisa pas dans ce pavillon
de Chatou. Questionné sur un assassinat qui avait été commis dans son refuge, il
affirma « Je n’ai jamais eu connaissance d’un crime qui aurait été commis dans
le pavillon où j’étais hébergé ». Il s’agissait du meurtre de Georges Déziré tué
le 17 mars 1942.
Les policiers lui présentèrent la photographie de Colin.
Était-ce celle d’Henri Colin qui s’occupait des hébergements des illégaux ? Il
affirma ne pas le connaître, refusa de parler de son propre rôle dans
l’organisation clandestine. Les policiers saisissaient une carte d’identité au
nom d’Émile Martin avec la photographie de Georges Wodli.
Incarcéré au dépôt de la préfecture de police ou/et à la
prison de la Santé puis à Fresnes. La Gestapo, qui le réclama, obtint son
transfert le 18 novembre et, le 16 janvier 1943, il fut transféré au camp de «
sécurité » de Schirmeck en Alsace annexée, où il fut mis au secret dans sa
cellule. Ce fut le début d’un long calvaire pour Georges Wodli, qui subit de
nombreux interrogatoires au siège de la Gestapo à Strasbourg où il fut
régulièrement torturé et battu. À Moscou, Maurice Thorez ignorait son destin
lorsqu’il écrivit, sous le pseudonyme de Jean, une évaluation le 15 mars 1943 :
« Membre du comité central ; Membre du Bureau régional d’Alsace ; Administrateur
du puissant syndicat des cheminots d’Alsace et de Lorraine. Très intelligent et
capable. Fut l’un des soutiens principaux du Parti dans la lutte contre le
groupe dégénéré Hueber-Mourer (1929). Grande autorité. Tendances personnelles. A
toujours des difficultés à travailler collectivement. Pas de nouvelles depuis la
guerre. » Il existe plusieurs versions sur les circonstances de son décès. La
plus vraisemblable indique que Georges Wodli serait décédé dans sa cellule le 2
avril 1943 à 9h30 du matin après une longue agonie à la suite de tortures.
Pour camoufler en suicide leur crime, ses tortionnaires nazis auraient alors
organisé une macabre mise en scène, simulant une mort par pendaison dans sa
cellule le 1er avril, version reprise par l’acte de décès « officiel ». Ramené
au camp de Schirmeck, le corps de Wodli aurait été aussitôt incinéré au four
crématoire du camp du Struthof distant de 8 kilomètres (cf. M. Choury, p. 92).
Selon certaines brochures communistes de l’après-guerre (Des français...,
Quelques biographies...), Georges Wodli aurait été emmené le 2 avril au camp de
concentration du Struthof dont tous les accès avaient été barrés à 5 kilomètres
à la ronde, pour y être pendu.
Au pied de la potence, il aurait alors adressé un message
de foi et de confiance en faveur du « grand Parti communiste » pour lequel il
avait milité et faisait le sacrifice de sa vie. Enfin, selon Jacquet (p. 185), «
Wodli, arrêté le 30 avril 1942, aurait été pendu le 1er avril 1943 dans les
locaux de la Gestapo de Strasbourg après avoir subi les pires tortures »,
infligées par les agents de la Gestapo Schleite, Wolters, Hilger et Wünsch.
Quoi qu’il en soit, Georges Wodli fut fait, à titre
posthume, chevalier de la Légion d’honneur avec le grade de sous-lieutenant,
décoré de la Croix de guerre avec palmes et de la Médaille de la Résistance.
Georges Wodli devint le symbole de la résistance communiste en Alsace-Lorraine.
En 1953, l’Union des syndicats des cheminots d’Alsace-Lorraine CGT édita une
brochure, Heimat unterm Hakenkreuz à l’occasion du dixième anniversaire de sa
mort.
Wodli est connu en Auvergne car c’est son nom qui fut donné
au principal camp et maquis FTPF de la région à partir de mars 1943, en
Haute-Loire, sous la direction d’Alain Joubert.
– RGASPI, 495 270 1484.
– Arch. Nat. F7/13129, 13130.
– Arch. PPo. GB 114 BS2 (notes de Daniel Grason).
– Arch. Dép. Bas-Rhin, 98 AL 723.
– Arch. Dép. Moselle, 310 M 95.
– Le Cheminot unifié, Strasbourg, 2 avril 1945.
– L’Humanité d’Alsace et de Lorraine, 7 février 1945.
– La Presse libre, Strasbourg, 18 mars 1945 (lettre de Georges Weill au sujet de l’assassinat de Wodli publiée à Albert le 12 août 1943) et 6 avril 1945.
– Des Français en qui la France peut avoir confiance, 1945 (1re éd. ; 2e éd. avec portrait).
– Quelques biographies de dirigeants du PCF.
– G. Walter, Histoire du Parti communiste, p. 278.
– Lettres de fusillés, Éd. Sociales, 1958.
– Albert Ouzoulias, Les Bataillons de la jeunesse, Les jeunes dans la résistance, Paris, Éd. Sociales, 1969.
– Maurice Choury, Les Cheminots dans la bataille du rail, 1970, p. 84-93.
– Jacques Jacquet, Les Cheminots dans l’histoire sociale de la France, 1967, p. 185.
– L’Humanité, 8 décembre 1944, 1er avril et 5 avril 1945.
– C. Hoeffel, Heimat unterm Hakenkreuz (Mon pays sous la croix gammée), édité par l’Union des syndicats CGT d’Alsace-Lorraine, à l’occasion du 10e anniversaire de la mort de Georges Wodli, Schiltigheim, 1953 (trad. de l’allemand par G. Bitte).
– Résistance in annektierten Elsass und Lothringen, Strasbourg, 1953 (numéro spécial de l’Humanité d’Alsace et de Lorraine).
– L. Burger, Le groupe Mario, une page de la résistance lorraine, Metz, 1965.
– B. Reimeringer, « Un communisme régionaliste ? Le communisme alsacien : 1920-1939 », Régions et régionalisme en France du XVIIIe siècle à nos jours, 1977.
– Gérard Diwo, Le communisme en Moselle (1925-1932) à travers les élections législatives d’avril 1928 et de mai 1932, M.M., Université de Metz, 1983, 176 p.
– Léon Strauss, « Le Parti communiste français en Alsace-Lorraine de la fin de 1938 à la fin de 1941 », Les Communistes français de Munich à Châteaubriant, Presses de la FNSP, 1987, p. 369-387 ; biographie de G. Wodli, Encyclopédie de l’Alsace, t. 12, Strasbourg, 1986.
– « Dernière lettre de G. Wodli à sa femme (1er novembre 1942) », Catalogue de l’exposition Strasbourg 1939-1945, Arch. mun. Strasbourg, 1992.
– L’Humanité, 5 avril 1993. – DBMOF, t. 43, p. 385-386.
– Renseignements fournis par Marguerite Obrecht.
– Notes Pierre Schill.
Copyright SHW 2023 - Webmaster Guy Frank