 Eugène Bouillon (1886-1966)
Eugène Bouillon (1886-1966)
Eugène BOUILLON : expulséEugène BOUILLON est né à Wintzenheim le 30 octobre 1886. Ses parents, Bouillon Auguste, boucher, et sa mère Schaffar Marie-Anne sont tous les deux francophiles. Son père le fait entrer comme interne au Collège des Frères de Marie à Saint-Dié-des-Vosges. Eugène grandit dans un milieu francophile et francophone. En 1915, il est enrôlé dans l’armée allemande. Tombé malade, il passe quelque temps à l’hôpital dans un quartier de Berlin. Le 14 juillet 1916, il part pour le front russe et, trois mois plus tard, il est dirigé sur le front du Nord de la France, à Liévin. Après plusieurs affectations, il a la chance d’être recruté comme interprète, devient chauffeur de camion et même cuisinier. Lors de la retraite générale vers l’Allemagne, il profite de l’opportunité pour quitter l’armée et trouver refuge à Liège. De là, il part pour Paris d’où il rejoint sa famille après de multiples péripéties. En 1918, après sa démobilisation, il reprend son exploitation agricole. En 1934, il publie, en français, un livre intitulé « Sous les drapeaux de l’envahisseur - Mémoires de guerre d’un Alsacien » où il laisse libre cours à ses sentiments francophiles et à sa détestation de l’Allemagne. Entre 1934 et 1935, il est maire de Wintzenheim. Lors de l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine en 1940, avec sa famille et pour cause de francophilie, il est expulsé le 14 décembre 1940 au-delà de la ligne de démarcation. Avec son épouse Jeanne née Butterlin, ses trois filles Yvonne, Jacqueline et Marie-Louise et son fils Ernest, il rejoint le camp d’Aussillon dans le Tarn, puis se réfugie à Cazals dans le Lot en juin 1941. La famille revient à Wintzenheim en 1945, s’installe de nouveau rue des Prés et reprend son activité. Les liens étroits avec le Lot sont maintenus, car deux des filles y fondent, après la guerre, leur propre foyer. En 1945, le maire de la Libération est Émile Tannacher. La vie reprend son cours pour l’organisation du fonctionnement de la commune. Après les élections municipales de septembre 1945, Eugène Bouillon est réélu maire, Alfred Freydrich devient 1er adjoint et Joseph Humbert 2ème adjoint. André Bruder est l’adjoint de Logelbach. Eugène Bouillon reste maire jusqu’en 1953. Il décède le 28 août 1966. Société d'Histoire de Wintzenheim, Marie-Claude IsnerSources : |
Französlinge : dans cette catégorie créée par les Allemands,
se retrouvent les membres de la Légion d'honneur, ceux du Souvenir français
(association pour l'entretien des tombes de guerre), les engagés volontaires
dans l'armée française en 1914-1918.
Source : L'Alsace dans la guerre 1939-1945, Bernard Le Marec et Gérard Le Marec
Eugène Bouillon : né le 30 octobre 1886 à Wintzenheim, décédé le 25 août 1966 à Wintzenheim, maire de Wintzenheim de 1934 à 1935 et de 1945 à 1953, fut expulsé avec toute sa famille le 14 décembre 1940. Il était l'auteur d'un livre "Sous les drapeaux de l'envahisseur - La grande bête de l'Apocalypse". En exil, il était accompagné de son épouse, Jeanne Butterlin, née à Wettolsheim le 03.06.1886, trois filles : Yvonne née à Wintzenheim le 23.10.1919, Jacqueline née à Wintzenheim le 18.11.1928, et Marie-Louise (Marlyse) née à Wintzenheim le 13.09.1930, et du fils Ernest, né en 1915.
Source : Jacqueline Nicod née Bouillon, 9 mars 2005
 Eugène Bouillon (1886-1966)
Eugène Bouillon (1886-1966)Eugène Bouillon naît en 1886 à Wintzenheim (en Alsace-Lorraine annexée)
dans une famille qui cultive le souvenir de la France. Son père, un
ancien combattant français de 1870, l’emmène par exemple assister au
défilé du 14 juillet dans la ville de Belfort, restée française. De
plus, Eugène passe une partie de sa scolarité en France comme interne au
Collège des frères de Marie à Saint-Dié (Vosges). Il baigne donc depuis
son enfance dans un milieu familial francophile et francophone.
Sa guerre commence en octobre 1915 quand il est enrôlé dans la garde
impériale de Berlin. Après un séjour au camp militaire de Döberitz, il
rejoint son cantonnement à Weissensee, un quartier de Berlin. Tombé
malade, il passe quelque temps à l’hôpital avant que son bataillon ne se
fixe finalement à Cöpenick. Le 14 juillet 1916, il part pour le front
russe. Après des haltes dans les villages de Novo Vileisk (Lituanie) et
Novozvenziani, il finit par débarquer à proximité du front à la station
de Soly (actuelle Biélorussie). Il ne reste que trois mois sur le front
russe et, au début de novembre, il est dirigé sur le front occidental
dans le Nord de la France. Le 7 décembre il arrive à
Hellemmes-les-Lille, puis est affecté dans la réserve au camp de
Sainghin. Là, il participe à la construction d’une position de réserve à
18 km du camp. En février 1917, à son retour de permission, il est
envoyé sur le front face aux Anglais à Liévin, à proximité de Lens. A
nouveau porté malade, il bénéficie de quelques jours à l’infirmerie,
puis rejoint un quartier de repos à Noyelles-sous-Lens avec toute sa
compagnie, où ils sont astreints à de nombreux exercices. De retour au
front, il occupe un temps une position d’avant-poste, avant d’avoir la
chance d’être recruté comme interprète dans le village de Drocourt. En
plus de cette fonction, il doit aussi s’occuper du cimetière des
soldats. En avril 1917, une offensive victorieuse de l’armée anglaise
oblige les Allemands à céder du terrain, ce qui conduit sa compagnie
jusqu’à Courtrai en Belgique. Là, il saisit deux opportunités qui se
présentent à lui : il est d’abord admis à une formation de chauffeur de
camion, puis devient cuisinier du parc automobile de Roubaix (sans doute
vers l’été 1917). Peu de temps avant l’armistice, il est même nommé
chef cuisinier d’un casino des officiers à Bruxelles. C’est là qu’il
assiste au mouvement révolutionnaire qui touche l’armée allemande au
début de novembre 1918, puis qu’il partage avec les Belges la liesse
populaire consécutive à l’annonce de l’armistice. Le conseil de soldats
(Soldatenrat) proclame sa démobilisation et organise la retraite
générale vers l’Allemagne. Une longue colonne de camions se met alors en
route, de laquelle il trouve l’occasion de s’échapper, jugeant le
moment opportun pour prendre congé définitivement de l’armée allemande.
Il rejoint alors la ville de Liège et trouve à loger chez des hôtes très
généreux qui l’hébergent durant trois semaines au cours desquelles il
assiste au long défilé des troupes allemandes en retraite. Il quitte
enfin Liège pour Paris avec neuf autres déserteurs alsaciens-lorrains à
bord d’un train rempli de prisonniers français libérés. Après avoir
transité au centre de triage du Grand Palais, les dix sont conduits au
camp pour Alsaciens-Lorrains de Villeneuve-Triage. Il y est employé
pendant trois semaines à charger et décharger des marchandises à la gare
de Charenton, avant d’être enfin libéré et de pouvoir rentrer en
Alsace. Il s’établit comme exploitant viticole à Wintzenheim et exerce à
deux reprises le mandat de maire. En 1940, l’Allemagne nazie
victorieuse annexe de fait le territoire de l’ancien Reichsland perdu en
1918. Notre auteur, Eugène Bouillon, tout comme une partie de la
population jugée indésirable, en est expulsé et doit se réfugier avec sa
famille dans le Lot.
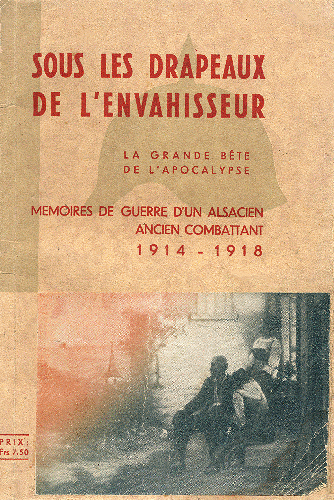 Sous les drapeaux de l’envahisseur
Sous les drapeaux de l’envahisseurEugène Bouillon, Sous les drapeaux de l’envahisseur.
Mémoires de guerre d’un Alsacien ancien-combattant 1914-1918,
imprimerie Messager de Colmar, 1934, 120 p.
Il semble que le témoignage, écrit après les faits, repose davantage sur
des souvenirs que sur des notes prises au cours des évènements.
Toutefois, celles-ci ont peut-être existé, comme nous le laissent penser
les quelques dates précises qui ponctuent le récit. Malheureusement,
dans l’ensemble, la chronologie des évènements manque de précision.
L’intention de faire de cet ouvrage une œuvre de propagande pour servir
la cause française en Alsace n’est pas dissimulée. Au contraire, Eugène
Bouillon donne le ton dès le titre : « sous les drapeaux de
l’envahisseur », l’envahisseur désignant l’Empire allemand qui a eu la
main sur l’Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918. Puis il débute sa préface
en précisant : « ces mémoires seront un témoignage de fidélité de
l’Alsace à la France ». Par ailleurs, sur la carte jointe à l’exemplaire
qu’il offre au sénateur du Haut-Rhin Sébastien Gegauff, on peut lire :
« Cher Sénateur, veuillez accepter ce livre à titre de propagande pour
la bonne cause. » Après ces avertissements, le lecteur ne s’étonnera pas
de lire un récit teinté d’une francophilie très prononcée, voire d’une
vision manichéenne des évènements. Le vocabulaire utilisé est évocateur :
« l’envahisseur » (p.17), les « boches » (p.18, 60), les « enragés »
(p.18), « nos bourreaux » (p.18), « la bête apocalyptique » (p.89)
désignent tour à tour les Allemands ou l’armée allemande, même si, bien
plus encore que l’ensemble des Allemands, ce sont les Prussiens et leur
caractère belliqueux qui attisent la haine de l’auteur (p.23, 25, 26).
En outre, le témoignage est ponctué de commentaires sur les méfaits
commis par les soldats allemands dans les régions occupées, que ce soit
en Lituanie (p.46, 47), dans le nord de la France (p.51, 61, 66, 67, 69)
ou en Belgique (p.82). On y trouve aussi un enthousiasme à peine voilé
quand il s’agit de décrire l’infériorité matérielle de l’armée allemande
(p.58-59), ses défaites et ses replis (p.92, 99) qui deviennent autant
d’occasions de vanter l’armée française et plus généralement la nation
française (p.86-87). En tant qu’Alsacien francophile revêtu de
l’uniforme feldgrau, Eugène Bouillon ne manque pas de sympathie pour les
prisonniers de guerre français (p.27), ou les Polonais et les Russes
subissant l’occupation allemande (p.35-36), c’est-à-dire pour toutes les
personnes rencontrées qui comme lui sont hostiles aux Allemands. Il
tente toujours d’entretenir de bonnes relations avec les civils,
notamment dans le nord de la France (p.62) et en Belgique, où il célèbre
le 14 juillet 1918 dans une maison bourgeoise de Roubaix et trinque
avec ses hôtes en l’honneur d’une victoire française prochaine (p.91).
L’ouvrage est donc partial, mais non dénué d’intérêt. On y suit le
parcours d’un soldat à l’expérience originale, qui porte un regard
curieux sur les régions qu’il traverse. La religion tient une place
importante dans sa vie et son récit est ponctué de références de nature
biblique (p.62, 71, 85, 97). Dès qu’il en a l’occasion il va prier dans
une église ou assister à un office (p.48, 50, 54), non seulement pour
trouver un réconfort personnel mais aussi plus largement pour le Salut
de la France (p.37, 41, 42, 43, 50, 78).
Surtout, ce témoignage permet de mieux comprendre l’extrême complexité
du cas des soldats alsaciens-lorrains de l’armée allemande. D’un point
de vue identitaire, la minorité nationale qu’ils forment est loin d’être
homogène : l’éventail est large entre ceux qui considèrent défendre
leur patrie dans l’armée allemande et d’autres comme Eugène Bouillon
qui, à l’inverse, ont l’impression de trahir leur nation (la France) en
combattant avec l’uniforme feldgrau. L’expérience combattante qui en
découle est donc tout aussi variée. Dans ce témoignage à charge contre
l’armée allemande, l’auteur ne manque pas de dénoncer la suspicion,
voire le mépris des officiers à l’égard des soldats alsaciens-lorrains.
Il semble y avoir été particulièrement sensible, autant en Allemagne
(p.28) que sur les fronts russe (p.38, 44, 45) et français (p.63),
allant jusqu’à prétendre l’existence d’une propagande diffusée dans
l’armée allemande pour stigmatiser les Alsaciens-Lorrains (p.45). Le
sentiment d’être des soldats de second rang est partagé par de nombreux
compatriotes qui vivent plus ou moins bien les différences de traitement
dont ils font l’objet : ces soldats se voient par exemple écartés de
certaines missions ou bien retirés de la première ligne pour être
affectés dans une compagnie de pionniers (p.74). Eugène Bouillon
lui-même passe du front à l’arrière en tant que traducteur, chauffeur
puis cuisinier d’un parc automobile. Ses conditions de vie s’en trouvent
très améliorées, étant donné sa moindre exposition à la mort et le
confort dont il peut jouir (notamment en matière d’alimentation et de
repos). Pourtant, selon l’auteur, cette mise à l’écart pose la question
du sens à donner à la mobilisation des Alsaciens-Lorrains dans cette
armée : Guillaume II, le « dieu allemand » (p.61), aurait opéré un
mauvais choix en décidant de les envoyer au front (p.82). Il explique,
en parlant des soldats alsaciens-lorrains comme « les honnis, les parias
du peuple allemand » (p.97) que ceux-ci n’avaient pas « l’élan » que
pouvaient avoir la grande majorité des soldats allemands (p.120). Au
contraire, en les employant, l’Empire allemand les a obligés à une «
lutte fratricide » (p.120) contre leurs frères français : « le boche me
met le poignard en main pour me faire tuer mes frères » et « trahir mon
sang » (p.34). Ce constat le décide assez tôt à déserter. Il y songe dès
son départ pour le front russe (p.34) et plus sérieusement encore à son
retour sur le front français (p.55, 58). Il élabore même un plan pour
s’enfuir en direction des lignes adverses tenues par les Canadiens ; il
le met à exécution mais est contraint d’abandonner au dernier moment
(p.59). Ce n’est qu’avec la déroute militaire et la situation
révolutionnaire de novembre 1918 qu’il peut enfin concrétiser ce vœu.
Au final, la rédaction puis la publication d’un tel témoignage semble
avoir pour but d’offrir à la France une preuve de patriotisme, ce qui
peut ressembler à une tentative pour se justifier d’un passé militaire
dans l’armée allemande vécu comme un complexe lourd à assumer depuis la
réintégration de l’Alsace-Lorraine à la France.
Il n’est donc pas étonnant qu'Eugène Bouillon figure dans la deuxième vague d’expulsion, le 14 décembre 1940, avec sa famille, car Eugène est expulsé avec ses proches. Ils se retrouvent alors au camp d'accueil d’Aussillon (Tarn) que la famille quitte en juin 1941 pour s'installer à Cazals, dans le Lot. En 1944, la famille est au Passage d'Agen (Lot-et-Garonne).
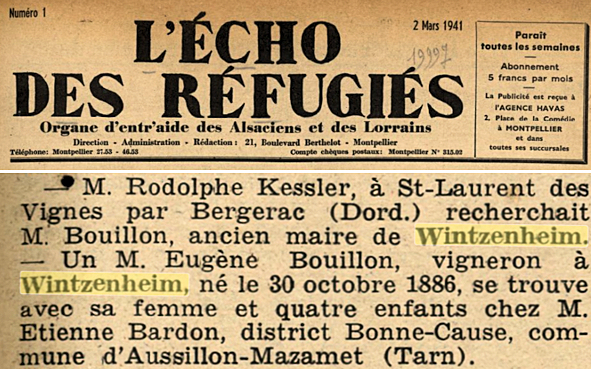 |
BOUILLON 10 2 mars 1941 Dans l'Echo des Réfugiés, une réponse à une annonce précise que M Eugène Bouillon, vigneron et ancien maire de Wintzenheim se trouve avec sa femme et quatre enfants chez M. Etienne Bardon, district Bonne-Cause, commune d'Aussillon-Mazamet (Tarn) |
 |
BOUILLON 03 1942 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Père Auguste Bouillon, Yvonne, Jacqueline, Marlyse |
 |
BOUILLON 04 1942 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Jacqueline, Père Auguste Bouillon, Marlyse |
 |
BOUILLON 05 1942 1ère messe du Père Auguste Bouillon au couvent des Rédemptoristes à Souceyrac (Lot) Jacqueline, Eugène Bouillon, Auguste, Jeanne, Melle Bisantz (la marraine), à l'avant : Marlyse |
 |
BOUILLON 07 1942 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Eugène, Auguste, Mlle Bisantz, Jeanne Assises : Marlyse et Jacqueline |
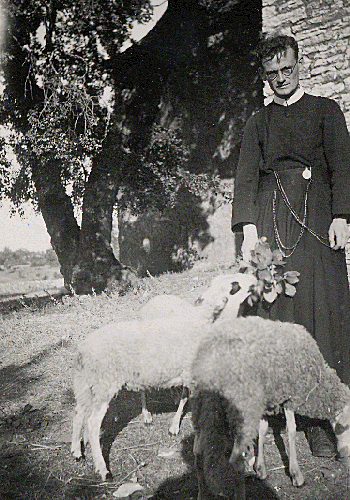 |
BOUILLON 08 16.08.1942 Le Père Auguste Bouillon à Cazals (Lot) |
 |
BOUILLON 02 27.03.1943 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Jeanne et Eugène Bouillon |
 |
BOUILLON 06 1944 Passage d'Agen (Lot-et-Garonne) Communion de Marie-Louise (Marlyse) Jeanne, Yvonne, Marie-Louise, Jacqueline, Eugène |
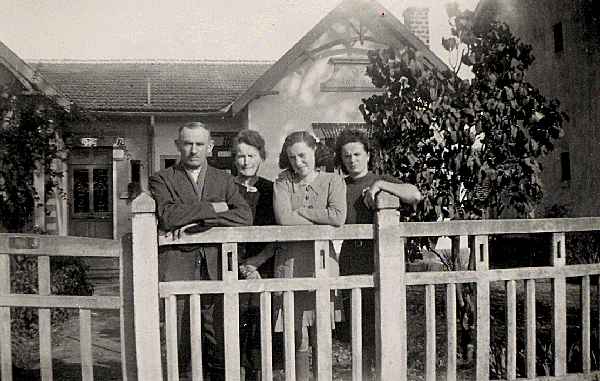 |
BOUILLON 09 1944 Famille Bouillon au Passage d'Agen (Lot-et-Garonne) Eugène, Jeanne, Jacqueline, Yvonne |
Nom marital : Jacqueline Nicod, Marlyse Groelly, Yvonne Sussmilch
(collection Jacqueline Nicod)
En arrivant à Lyon après notre périple jusqu'à
Montreux-Château j’ai trouvé parmi mon courrier une lettre de Monsieur BOUILLON,
un habitant de Wintzenheim qui avait été expulsé au mois de Juillet 1940 avec
toute sa famille parce qu’il avait écrit un livre anti-Fritz « Sous le drapeau
de l’envahisseur » et ceci entre les deux guerres. Paysan, il avait loué une
ferme avec 45 hectares de terres, de forêts et de prés autour. Dans cette lettre
il m’invite à venir passer une quinzaine de jours chez lui à Cazals dans le
Lot ; la ferme s’appelait « Gagnepot ».
J’ai donc décidé de donner suite à cette invitation avant
de reprendre mon travail. Il fallait aller jusqu'à Cahors et là prendre le car
jusqu'à Cazals qui se trouvait à environ 40 kilomètres de Cahors. Mais comme
c’était un coin perdu, il n’y avait qu’un car qui circulait par semaine et
c’était un vendredi ; il partait le matin et rentrait dans la soirée.
Arrivé à Cazals on m’a dit que la ferme en question se
trouvait sur une colline à 20 minutes de marche. Arrivé à la ferme on m’a
demandé de suite des nouvelles de Wintzenheim et on m’a signalé également qu’à
200 mètres de la ferme habitait un autre expulsé de Wintzenheim avec sa femme ;
c’était le pharmacien qui était le président de la section U.N.C. de Wintzenheim.
Le lendemain de mon arrivée, j’ai croisé Monsieur LUCKERT,
le pharmacien, et il m’a invité à passer également quelques jours chez lui.
C’était d’ailleurs chez lui que j’ai appris par la radio l’évasion du
général GIRAUD de la forteresse de Koenigstein, comme il l’avait déjà fait
pendant la guerre 1914-1918. Il avait traversé l’Alsace du Nord au Sud sans
problème alors que les Fritz avaient mis sa tête à prix, ils promettaient
100.000 marks à qui aiderait à sa capture mais personne les voulait.
C’est un jeune que je connaissais bien, Henri KUPFER,
garde-forestier à la frontière suisse qui lui a fait traverser la frontière près
de la ferme « Les Ebourbettes ». Il nous a déçus par la suite parce qu’il s’est
mis à la disposition du maréchal au lieu de rejoindre Londres.
A Cazals où on cultivait tout, surtout les haricots blancs,
on pouvait encore se rassasier, les paysans ne pouvant plus se défaire de leur
récolte vu qu’il n’y avait pas de moyen de transport, les Fritz ayant confisqué
presque tous les wagons de marchandises et les gros camions. J’ai réussi à
acheter chez un paysan 25 kilos de haricots blancs que j’ai fait envoyer chez
Madame WOEHRLE à Lyon et qui sont bel et bien arrivés à la bonne adresse. A la
suite de cet arrivage on a mangé pendant deux mois des haricots blancs tous les soirs.
Copyright SHW 2025 - Webmaster Guy Frank